Innovation & technologie | Crue / Inondation
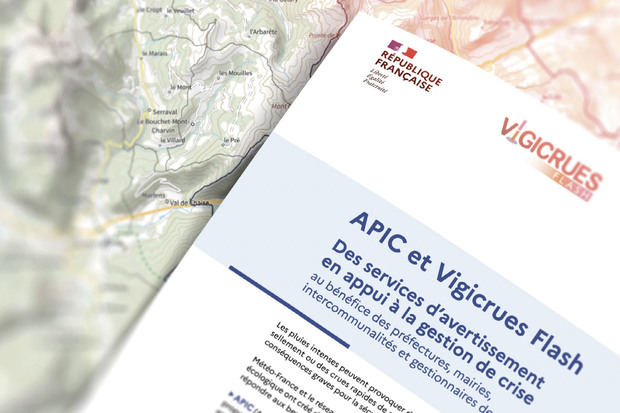
Il est important de rappeler que depuis mars 2021, ce service APIC est disponible sur la totalité des communes de métropole, alors que 7 % du territoire en était exclu antérieurement (dont les reliefs de Savoie « intérieure »). Ce progrès indéniable a été permis par une nouvelle technique d’estimation en temps réel des lames d’eau à résolution kilométrique et pas de temps quart-horaire. L’avertissement aux pluies intenses se base désormais sur la fusion des informations issues des radars hydro-météo et des pluviomètres opérés par Météo-France (lame d’eau « Antilope » temps réel).
Pour autant, cette évolution ne doit pas faire oublier qu’en ce qui concerne les zones montagneuses savoyardes, la couverture radar n’a pas progressé depuis la fin des années 2010, avec l’installation du radar du Moucherotte en Isère et l’intégration des données du radar suisse de la Dole.
Les exemples cités ci-dessus de « non-avertissements » APIC (avertissements à ne pas confondre avec alertes, du domaine du pouvoir de police) montrent sans ambiguïté que les APIC ne sont pas fiables à 100 % sur ces zones. Face au risque torrentiel, majeur en territoire de montagne, penser être averti d’un épisode pluvieux potentiellement dangereux alors que le système n’est pas sans faille ajoute un « sur-risque » dont les collectivités montagnardes se passeraient volontiers !
Un bref retour d’expérience, mené avec les services de Météo-France et ceux du Service de prévision des crues Alpes du Nord, nous amène à considérer qu’il ne semble pas pertinent d’incriminer le « calibrage » du service (durées de retour 10 et 50 ans déclencheurs des APIC). Rappelons ici qu’il est illusoire d’associer directement fortes précipitations et crues torrentielles, car nature et humidification des sols concernés jouent un rôle prépondérant. Toutefois, l’analyse de ces « non-APIC » conduit à une probable sous-estimation des lames d’eau Antilope utilisées en temps réel, principalement basées sur les données radar.
Ainsi, dans le cas du violent orage survenu à La Bathie le 11 juin 2023 entre 20 et 22 h, la lame d’eau en temps réel n’a pas déclenché d’avertissement. Par contre, la technique se complète d’une autre lame d’eau, réanalysée le lendemain (dite « Antilope J+1 ») ; elle intègre un maximum d’observations de pluviomètres indisponibles en temps réel et sert de base à l’analyse a posteriori, par exemple pour les demandes de classement en catastrophe naturelle. Pour l’épisode orageux de la Bathie, l’Antilope J+1 fait apparaitre cette fois des valeurs maximales supérieures de quelques millimètres à la valeur décennale qui sert au calibrage du service APIC. Le constat est le même pour l’orage survenu sur les hauteurs d’Ugine le 13 juin 2023 vers 16 h.
En conclusion, il semble très probable que la cause de ces « non-avertissements » APIC en Savoie provienne de la couverture radar insuffisante de ces zones de montagne, principale source de données en temps réel pour les APIC. Il s’agit bien d’une limite technique du système en l’absence de radar sur ces territoires.
Si la faiblesse de la couverture radar des « Savoies intérieures » ne semble pas contestable, se pose alors la question de la manière d’améliorer la fiabilité du service APIC pour ces territoires alpins. À l’heure actuelle, tout projet d’extension du réseau radar opéré par Météo-France semble avoir été abandonné, mais sans que cela ait été clairement annoncé par les services de l’État. À la décharge de la politique menée en la matière par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), il faut avoir à l’esprit que :
Les collectivités de montagne s’interrogent donc sur leur couverture APIC, un service pourtant très utile en appui de leur Plan communal de sauvegarde. Elles sont légitimes à demander une vision claire des performances du service de l’État les aidant face à ce risque torrentiel annoncé en hausse avec le changement climatique.
Il serait souhaitable que le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires précise sa stratégie en la matière, car rien n’a été communiqué depuis les initiatives savoyardes qui demandaient en 2019 l’inscription d’un nouveau radar en Savoie au contrat de plan État-Région, sans suite à notre connaissance.
Au-delà de cette question d’équipement technique à préciser, de nombreux axes d’amélioration sont envisageables pour mieux faire face aux risques à cinétique rapide comme le torrentiel. On peut clairement penser à la prise en compte de la fonte neigeuse et de l’état d’humidification des sols au moment des fortes précipitations. Il semble aussi nécessaire de rénover la vigilance météo « fortes pluies-inondation » afin que ce risque bénéficie d’une meilleure visibilité dans des départements de montagne très touristiques. À plus long terme, si la fiabilité des APIC est améliorée sur tout le territoire, la possibilité d’une utilisation locale de Fr-Alert en mode « réflexe automatisé » pourrait même être étudiée pour améliorer la sécurité des personnes en montagne sans attendre de nouveaux drames.
// Article paru dans la revue "Risques Infos" n°47, septembre 2024, à consulter ici ou là :






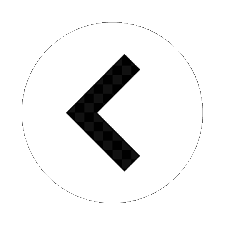
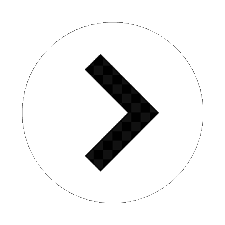
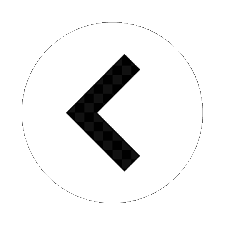
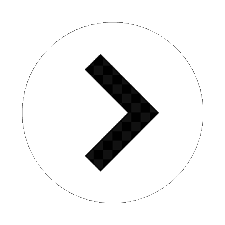
Ou inscrivez vous
x Annuler